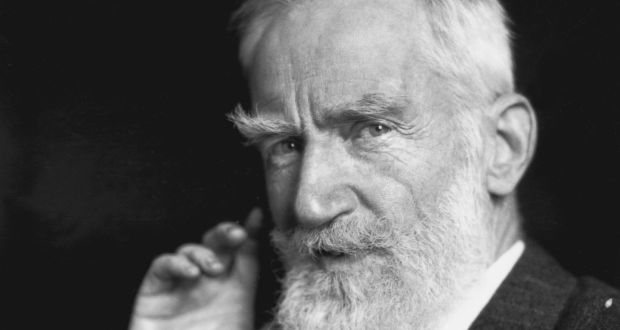Ne reculant devant rien, j'ai choisi pour titre de ce billet à haute concentration philosophique celui de la thèse soutenue autrefois par Anicet Broutard, titulaire de la chaire d'ontologie créative au Collège de France, et accessoirement l'un des plus réjouissants personnages du nouveau roman de Michel Desgranges. Pour ceux qui ont eu le bon goût et le plaisir de lire Une femme d'État, du même et chez le même éditeur (Les Belles Lettres), il s'agit là du second tableau de ces Mœurs contemporaines dans l'étude desquelles notre auteur s'est courageusement et brillamment lancé. Et Dieu seul sait, peut-être, jusqu'où cette exploration le mènera !
D'emblée, le lecteur des Philosophes est plongé dans la tragédie la plus radicale. Anicet Broutard, déjà évoqué, se trouve dans un rayon de supermarché, son philosophone à la main et dûment branché, lequel appareil vient de lui rappeler qu'il est censé rapporter à Mélanie, sa douce épouse (et savoureux personnage, elle aussi !), un bidon de produit adoucissant pour le linge. Et c'est le drame :
« Il n'y avait pas un bidon du produit recherché, mais exactement onze, de marques et de contenances différentes, qui semblaient tous avoir les mêmes qualités, et de manière également superlatives. Il se trouvait donc devant ce que son École nommait un être-totalité plurielle et ses collègues mathématiciens un ensemble, et il allait devoir rassembler forces, énergie et même courage pour provoquer dans ladite totalité une rupture radicale en en extrayant un élément ; […] »
On ne déflorera aucun suspense en révélant qu'Anicet Broutard va piteusement échouer dans cette mission. Mais, dès ces deux ou trois premières pages, le lecteur se retrouve plongé dans un monde délirant, asilaire, psychiatriquement administratif, auquel, en essayant de le penser, nos malheureux philosophes ne font qu'ajouter un peu plus de confusion, une rasade d'irréalité supplémentaire. Et le lecteur, déjà réjoui par le sens du cocasse et du saugrenu que déploie l'auteur, et qui semble inépuisable, se dit qu'il se trouve en face d'une pochade qui va lui faire passer un bien agréable moment d'hilarité bon enfant.
Il se trompe.
Oh ! certes, il va rire beaucoup et souvent, ce lecteur ! À chaque paragraphe, en vérité. Mais, parallèlement, il va sentir poindre en lui une sourde inquiétude. Quelque chose comme cette à peine perceptible amorce de douleur que l'on ressent juste avant qu'un mal se déclare pour de bon. Car ce monde totalement fou, pris dans les rets d'une bureaucratie qui aurait fait reculer Kafka lui-même, il va se mettre assez vite à lui en rappeler un autre, et de plus en plus à mesure que les pages se tournent. Le nôtre, évidemment. Pas le nôtre dans tant de mois ou dans X années : non, le nôtre maintenant. Michel Desgranges n'est pas un caricaturiste, c'est un portraitiste. Ou, si l'on préfère, un paysagiste. Il rend compte très scrupuleusement de ce qu'il voit autour de lui, autour de nous, mais en ayant pris soin de faire tomber les palissades équitables et bariolées qui tentent de dissimuler la réalité des villes, et s'être employé à laver les couches de maquillage citoyen dont nos contemporains se peinturlurent la face avant de s'exhiber à l'air libre. Si bien que ce que l'on prend d'abord pour les trouvailles cocasses d'un satiriste hors pair sont en fait les observations objectives d'un moraliste qui n'estime même plus nécessaire de se moquer : il lui suffit de mettre dans la lumière ce que nous ne voyons pas encore tout à fait distinctement pour outrager le monde, ainsi que le recommandait Philippe Muray.
Je ne donnerai qu'un exemple (après en avoir coché des dizaines…) de ce phénomène. On le rencontre aux pages 166 et 167 du roman. Le passage met en scène Laurent, ancien haut fonctionnaire, le seul transfuge du roman précédent, Une femme d'État. Pour des raisons que le lecteur découvrira, et qui n'importent pas ici, notre énarque a décidé de faire élire Anicet Broutard à l'Académie française. Et il voit se dresser devant lui un obstacle de taille :
« […] il découvrit qu'une forte bourrasque de parité réparatrice menaçait de perturber les prochaines élections académiques. Tout était né de quelques touitts glapis par des associations bien en cours (collectifs de poétesses violées, ethnologues abusées et romancières harcelées) qui avaient observé que s'il était bien gentil d'élire désormais autant de femmes que d'hommes, quid du passé ? D'un passé où il crevait les yeux que les différentes classes de l'Institut avaient été peuplées depuis leur création d'un nombre d'hommes infiniment supérieur à la quantité de femmes auxquelles fut octroyé un habit vert ? Il était facile de faire le compte (il fut fait, par un collectif de doctorantes en muséographie) et d'en déduire combien de femmes devraient désormais siéger dans les diverses Académies pour que soit pleinement réparée une aussi sexiste injustice (selon les estimations d'un collectif d'intermittentes du spectacle et statisticiennes du dimanche, ce n'est qu'à partir de l'an 3029 que l'on pourrait à nouveau autoriser un homme à entrer à l'Institut). »
Se produit là le phénomène que j'évoquais plus haut. Dans un premier temps, le lecteur laisse fuser un petit rire sardonique, tout en rendant hommage à l'imagination de l'auteur. Aussitôt après son rire se fige, lorsqu'il acquiert l'intime mais absolue conviction que, au moment même où Michel Desgranges écrivait le paragraphe qu'on vient de lire, quelque part en Europe, ou en Amérique du Nord, les membres et membresses d'une quelconque association lucrative sans but étaient bel et bien en train de réfléchir à cette même parité réparatrice. Et de le faire très sérieusement, avec le soupçon d'indignation vertueuse nécessaire. Et il en va à peu près de même pour les situations et péripéties a priori cocasses qui ne cessent de survenir à flot presque continu : c'est parce qu'elles ne sont cocasses qu'a priori qu'elles deviennent rapidement inquiétantes, ou au moins refroidissantes.
Il s'ensuit que le lecteur, d'abord enclin à se moquer des malheureux philosophes qui se débattent dans cette gabegie et tentent de la penser, ce lecteur se met à s'apitoyer sur eux, éprouverait bientôt le besoin de les réconforter. Bref, s'il continue à bien voir leur imposture, et s'il n'est pas encore prêt à faire d'eux des héros, il lui semble nettement qu'ils sont perdus dès le départ, condamnés d'avance. Et il se sent tout disposé à les regarder comme de simples victimes.
Ce serait trop se presser. Car le livre de Michel Desgranges n'est pas un simple tableau descriptif des aberrations contemporaines, même s'il est aussi cela, et avec une puissance comique difficile à égaler : c'est surtout un roman. Ce qui revient à dire qu'il va s'y passer des choses qu'aucun des protagonistes n'aurait jamais pu prévoir, même dans ses plus lovecraftiens cauchemars. Et ce qui survient soudain va chambouler le jeu des pensionnaires de l'asile-monde aussi sûrement que le Woland de Boulgakov débarquant dans la Moscou stalinienne. Son nom, à ce Diable, à cet ancestral et implacable ennemi des philosophes depuis des amas de lustres, est encore plus terrible qu'aucun de ceux que l'on connaissait dans les siècles passés, nul ne peut le prononcer sans trembler, tant sont noires les perspectives de destruction qu'il fait planer sur notre château de cartes biseautées.
Il s'appelle… le RÉEL.
Parvenu à ce stade, le critique ne peut que s'arrêter et rentrer dans le silence. Car les effets de l'irruption que l'on vient d'évoquer passent les pouvoirs de sa plume – et même les touches de son clavier ont tendance à sauter toutes seules hors de leur support métallisé. Et puis, il sait que ce n'est pas à lui, ni même à l'auteur, d'apporter la réponse à la question posée dès l'entrée du roman, « imposteurs ou héros ? ». C'est désormais au lecteur de s'y coller. Qu'il pense à se munir d'une gourde de gnôle et d'un gilet de sauvetage : ça va tanguer méchamment durant la traversée.